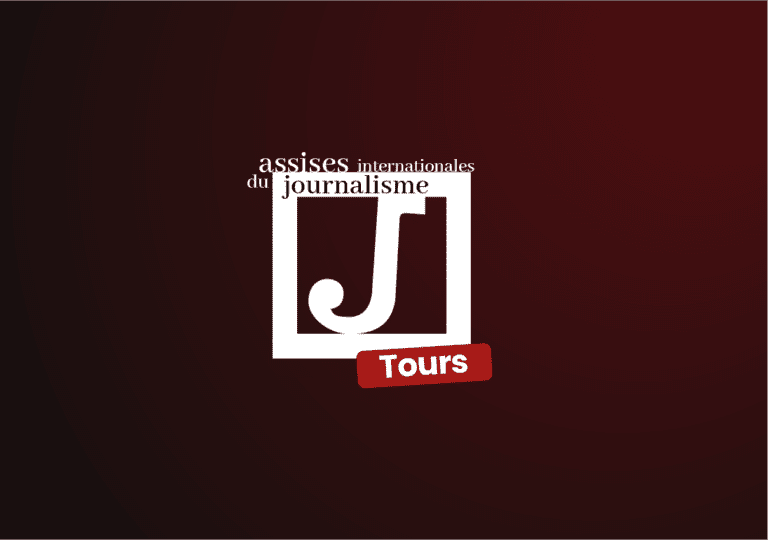Charon Jean-Marie, sociologue spécialiste des médias, chercheur associé à l’EHESS, livre, pour les Assises, son regard sur l’avenir du métier de journaliste.
La mutation radicale que connaissent les médias déstructure leurs modèles économiques, en même temps que les usages du public dans la recherche de l’information se transforment radicalement. Une profonde incertitude préside à la transformation de « l’écosystème » de l’information. Dans leur réponse à cette nouvelle donne les entreprises de presse expérimentent une transformation cruciale qui concerne l’organisation des rédactions, jusqu’ici principalement concentrées au coeur de celles-ci. Une forme nouvelle se fait jour qui peut être qualifiée de « rédaction ouverte ». L’hypothèse développée ici est qu’elle s’imposera sur la décennie qui vient et au-delà, d’abord dans la presse quotidienne. Elle est en effet la seule qui puisse répondre aux attentes du public en matière de qualité de l’information.
Tension sur les ressources
Difficile d’engager une prospective sur le journalisme sans évoquer les modèles économiques des médias, particulièrement de la presse quotidienne, tant ils sont bouleversés, confrontés aux incertitudes concernant leurs recettes tendanciellement en repli : une baisse des ressources publicitaires (2) se cumule au recul de la vente des publications, sous la pression, notamment pour le public le plus jeune, du modèle de gratuité (3). Qu’elles soient profondément fragilisées (presse imprimée) ou en ressentent déjà les effets (radio et télévision), les entreprises allègent leurs coûts et doivent monétiser l’information.
L’allègement des coûts n’épargne pas les rédactions4, dans un contexte de multiplication des supports, qui requièrent chacun une approche éditoriale propre. La tendance est au traitement de l’information 24 heures sur 24, avec moins de journalistes, davantage généralistes, plus nombreux à se consacrer à l’éditing, aux dépens des rubricards et des collecteurs de l’information.
La monétisation de l’information est la réponse tant au reflux publicitaire qu’à la gratuité. Dans la mesure où toute information disponible partout a vocation à être gratuite, il n’est d’autre argument pour convaincre un public habitué à cette gratuité que de lui proposer de l’original, du singulier, de l’enrichi. Les stratégies basées sur l’abonnement sont vouées à l’échec avec une offre inchangée. L’enjeu est de concevoir, expérimenter, et développer une information à valeur ajoutée, crédible, compétente, face à un public exigeant, critique, demandeur, prêt à la financer (5).
Recherche horizontale de l’information
Les usages du public se transforment, avec une recherche de l’information « horizontale », au sens où chaque utilisateur circule de site en site via des liens, en s’appuyant sur les moteurs de recherche (à commencer par Google), les plateformes d’échange (YouTube) et les réseaux sociaux. Cette recherche horizontale est dominante chez les plus jeunes ou dans des pays tels que les États-Unis. Elle se propage rapidement à l’ensemble des publics (6). Face à cette circulation horizontale des utilisateurs, les journalistes sont de plain-pied avec ceux-ci, à commencer par les détenteurs d’informations inédites (témoins, porteurs d’alertes) ou d’expertises particulières (universitaires, chercheurs, praticiens de la santé, de l’éducation, etc.). Face à une société dont le niveau d’éducation s’élève régulièrement, la distinction s’estompe entre journalistes et non journalistes, dans le registre de la connaissance. C’est une opportunité pour identifier des partenaires (contributeurs potentiels) avec qui coproduire différentes formes d’articles et contenus, en même temps que nourrir la stratégie éditoriale.
Rédactions ouvertes
Pris dans la tension entre l’allègement des effectifs des rédactions, les exigences de qualité d’un public prêt à payer l’information, sans compter les modalités d’usages « horizontaux », une forme de rédaction émerge qui ira en se généralisant : la rédaction ouverte ou en réseau. Celle-ci a d’abord germé dans le contexte de la presse magazine des années 80-90. Elle se dessine désormais dans des médias d’actualité chaude, tels que des pure players participatifs, mais aussi des quotidiens, à l’image du Guardian, où un pôle participatif dirigé par un rédacteur en chef comprend une dizaine de journalistes, dont la vocation est de développer le contributif (7) en recueillant les témoignages, alertes, suggestions des utilisateurs(8).
Il est possible de décrire quelques traits caractérisant les rédactions ouvertes, sachant qu’elles présentent l’avantage de la flexibilité, avec des formes variées et évolutives.
La rédaction ouverte s’appuie sur un noyau resserré de journalistes permanents, où dominent l’encadrement, l’éditing, l’activation du participatif, les collecteurs d’information tout terrain et généralistes. Ce noyau collabore avec d’autres journalistes spécialisés. Ces derniers sont choisis pour leur compétence. Ils peuvent être indépendants (pigistes) ou en agences (généralistes ou spécialisées).
Le noyau rédactionnel permanent travaille également, en interne comme en externe, avec d’autres professionnels de l’information, non journalistes (data scientist, statisticiens, développeurs, designers, graphistes, etc.). Il coproduit, par ailleurs, différentes formes d’articles et contenus avec des experts, qu’il identifie, choisit, accompagne dans cette production (cf. HuffingtonPost, etc.). Il peut aussi ponctuellement accompagner des personnes du public, en position d’enrichir l’information par leur témoignage sur un événement ou un sujet qui fait tendance à un moment donné. Là aussi des agences se sont spécialisées dans cette captation des différentes formes de contributions du public, à l’image de Storyfull ou de Citizenside.
La rédaction est également ouverte dans l’espace par le développement de démarches mutualisées pour traiter des sujets qui dépassent les moyens d’un seul média, telles que des enquêtes, ou des masses de données, à l’image des 400 journalistes de 108 médias ayant coopéré dans le cadre de l’ICIJ, à propos des « Panama papers ». L’ouverture dans l’espace passe en même temps par le recours à des agences et start-up de contenus avec lesquelles les rédactions collaborent. Celles-ci sont des espaces de journalisme installées dans des espaces de travail (coworking par exemple) où se croisent des informations et problématiques de traitement d’autres domaines (institutions, ONG, associations, entreprises)(9). Simultanément l’ouverture se fait par l’engagement dans des dispositifs et procédures de coréalisations d’innovations, auxquels contribuent des centres de recherche, des départements universitaires, des écoles (de design, d’informatique, de journalisme), à l’image du Hiblab de OuestMédiaLab10.
La rédaction ouverte s’expérimente dans des pure players d’information et des rédactions de médias plus classiques. Elle précise et valide les types de partenaires qui l’accompagnent telles que les agences et start-up spécialisées. Elle invente progressivement les protocoles de relations, les procédures de coopération – coproduction avec les autres professionnels du traitement des contenus, avec les non journalistes issus du public. L’enjeu est crucial dans un contexte totalement renouvelé de la relation entre les journalistes et la société. Une société où la connaissance s’est diffusée. Une société familiarisée à l’utilisation des outils de captation et traitement de l’information. Une société où les personnes du public accèdent à une pluralité de contenus informatifs dont une large part n’émane plus des médias d’information.
Questions et défis
À ce jour, les médias qui entrent le plus facilement dans ce modèle de la rédaction ouverte s’adressent et échangent avec des publics éduqués, dotés d’une forte appétence pour l’information, souvent prêts à rémunérer celle-ci. Qu’en est-il en revanche d’une offre médiatique plus populaire, restée longtemps fidèle aux mass médias, à commencer par la télévision généraliste? (11) Le défi est entre les mains des médias s’adressant traditionnellement à des publics moins « compétents », moins motivés par l’actualité, telles que les éditeurs de presse locale. Les réponses moins nombreuses émergent cependant, encore rugueuses. La décennie est cruciale afin d’éviter que se creuse le fossé entre les publics et se crustallise un système dual de traitement de l’information.
(1) Ce texte est nourri par l’enquête réalisée à la demande de Fleur Pellerin (« Presse et numérique l’invention d’un nouvel écosystème », juin 2015), ainsi que par la mission conduite par Jérôme Bouvier concernant « l’émergence et l’incubation » au service de l’innovation éditoriale.
(2) Cf. chiffres IREP : en 2015 : TV = 0,6%, radio = 0,8%, presse écrite = 5,9%
(3) Cf. chiffres de l’Observatoire de l’ACPM : 3,82% en 2015 pour la presse grand public
(4) Cf. chiffres de l’ASNE pour la presse américaine ( 10% en 2014) ; Mémoire de Sébastian Compagnon (-30% de journalistes dans la décennie 2000 aux États-Unis) ; chiffres du baromètre annuel des Assises du journalisme.
(5) Cf. Jean-Marie Charon : « Financement du journalisme : les lecteurs à la rescousse », Inaglobal, 12 octobre 2016.
(6) Selon le Pew Research Institut, les abonnés à Facebook et à Twitter seraient 63% à en faire leur premier moyen pour leur recherche de l’information. L’enquête Harris Interactive pour les Assises du journalisme de 2016 révélait que 43% des personnes interrogées déclarent consulter les réseaux sociaux comme source d’information, ce chiffre monte à 74% pour les moins de 25 ans.
(7) Cf. Jon Henley « La place du public dans la stratégie du Guardian », in JM. Charon et J.Papet (sous la direction) : « Le journalisme en question – Nouvelles frontières des médias et du journalisme », L’Harmattan, 2016.
(8) Jon Henley, idem.
(9) Interventions de Karen Bastien et Nicolas Vanbremeersch à la 7e journée de la presse en ligne (9/12/2016) par la télévision généraliste ?
(10) Où se croisent les journalistes de nombreux médias de l’ouest, start-upers, enseignants et étudiants en design, informatique, etc.
(11) Le défi est entre les mains des médias s’adressant traditionnellement à des publics moins « compétents », moins motivés par l’actualité, telles que les éditeurs de presse locale. Les réponses moins nombreuses émergent cependant, encore rugueuses. La décennie est cruciale afin d’éviter que se creuse le fossé entre les publics et se cristallise un système dual de traitement de l’information.