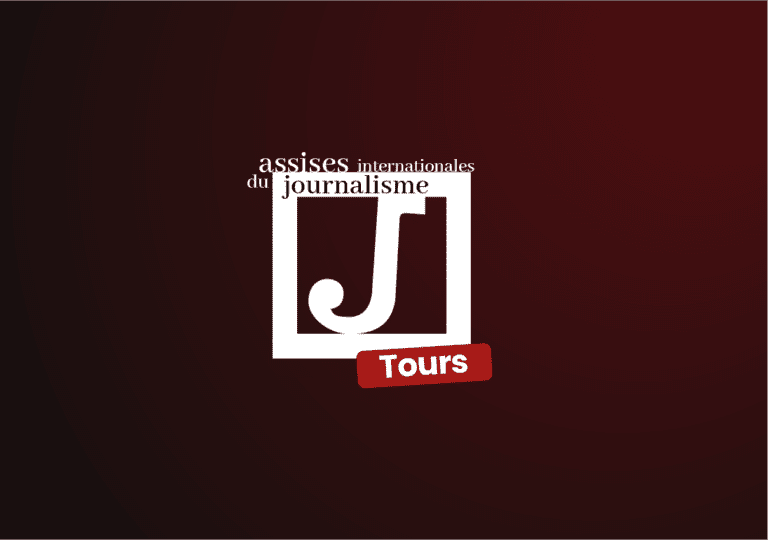Tristan Mendès France, enseignant nouveaux usages du numérique au Celsa, livre, pour les Assises, son regard sur l’avenir du métier de journaliste.
Des milliards de données géolocalisées par des milliards d’individus. Une masse inconcevable de données publiques épinglées autour de nous dans un espace d’exploration quasi infini. Voilà l’écosystème dans lequel j’imagine le journaliste de 2027.
Toutes les séquences de son travail sont bouleversées. Que ce soit l’investigation, l’agrégation de données d’abord, le rendu et sa diffusion, ensuite.
Journée type. Avant de réaliser son sujet, le journaliste se lance dans son travail d’enquête. Il part sur le lieu d’un fait divers qu’il compte couvrir, et s’équipe de ses smartglasses qui lui permettent de voir des données géolocalisées autour de lui en réalité augmentée 1. Sur place, il observe les traces numériques géolocalisées par les individus présents, à la recherche de témoignages intéressants. D’un geste, il déplace le curseur temporel de la séquence pour en saisir la survenance. Deux minutes avant le drame, il remarque une courte vidéo géolocalisée à gauche de l’entrée. Celle d’un couple qui signale leur présence. En arrière-plan, on devine déjà la silhouette de l’individu qui sera arrêté quelques heures plus tard. Le journaliste peut commencer à recueillir les éléments qui lui permettront de raconter son histoire.
On retrouve le même journaliste l’après-midi même au milieu d’une grande manifestation s’étendant sur deux kilomètres. En marchant au côté des manifestants, il s’équipe encore une fois de ses smartglasses et regarde à l’avant du cortège, un kilomètre devant, à l’affût de photos, statuts sociaux, ou toute donnée géolocalisée, lui permettant d’identifier 1 Il existe déjà aujourd’hui une application du nom de Layar (ios/playstore) qui permet de regarder en réalité augmentée (avec ou sans lunettes) les tweets et instagrams géolocalisés autour de nous. Assises_livret2017_INT_DEF.indd 40 06/03/2017 15:16 41 des personnalités d’intérêt. Distinguant sur un statut social un meneur qu’il veut interroger, il va à sa rencontre. Quelques minutes plus tard, regardant derrière lui, il aperçoit dans les données laissées en fin de cortège, deux kilomètres en retrait, des débordements. Il décide d’aller y voir de plus près.
Le journaliste de 2027 est devenu un journaliste augmenté qui filtre son environnement géolocalisé. Il travaille comme un archéologue du virtuel, fouillant les strates de données numériques laissées par d’autres. Mais ça n’est qu’une partie de son travail. Parce que si cet espace virtuel est un lieu de recherche de données, il est aussi un lieu d’écriture géolocalisée. Car l’accès à l’information, la façon dont elle est consommée par les lecteurs, se fait également via l’endroit où ils se trouvent. Avec l’idée de répondre à cette simple question : quelle est l’actualité de ce qui se trouve devant moi. Et pour y répondre, les journalistes géolocalisent leurs articles.
Un article portant sur un vieil immeuble est localisé à l’endroit même où il se trouve et est donc consultable par les passants. Ils y apprennent par exemple qu’une activité culturelle éphémère s’y est tenue la veille. Les articles peuvent également être accessibles sur les points relais d’un parcours spécifique. Le reportage se présente alors sous la forme d’une série de billets consultables à différents endroits.
La géolocalisation des articles ne porte pas que sur les bâtiments ou les lieux physiques fixes, mais aussi sur les objets, les meubles, ou toutes choses connectées. Lorsque le créateur d’un fauteuil de collection qu’on a chez soi décède, l’article sur le sujet devient disponible virtuellement au point de localisation de toutes ses créations (du moment qu’elles sont connectées). Tout individu rentrant chez lui peut recevoir l’actualité des objets qui l’entourent. Il peut lui être notifié par exemple que sa bouilloire a été signalée comme défectueuse dans un article sur le sujet.
L’écriture même des billets est impactée par la façon qu’ont les lecteurs d’accéder à ces contenus journalistiques. On ne s’adresse pas à un passant comme on s’adresse à un lecteur traditionnel. Les « Vous êtes actuellement sur le lieu de telle actualité / cet objet est associé à telle autre actualité » sont devenus des standards en début de billet.
Une relation de proximité apparaît entre le lecteur et le journaliste. L’espace physique devenu le lieu d’une écriture virtuelle donne la sensation que le journaliste est partout à la fois, que le journalisme est total. Présent dans le monde réel par le truchement du virtuel, l’environnement tout entier est journalisé, sur Terre, mais pas que. Les articles sont aussi géolocalisés Assises_livret2017_INT_DEF.indd 41 06/03/2017 15:16 42 dans l’univers extra-terrestre. Un article sur les dernières découvertes concernant Mars sera également localisé sur l’astre. Un pari audacieux à l’attention des voyageurs de demain (qui arrivent bientôt).
Reste un écosystème ouvert et peu régulé qui nécessite une précaution particulière, car ce qu’on y trouve souffre d’un véritable fléau : les fausses infos géolocalisées. Ces dernières ont pour objectif d’influencer notamment les journalistes qui passeraient à proximité. Il y a par exemple ce commerçant qui paye pour de faux témoignages dithyrambiques géolocalisés dans son magasin. Ou ce spéculateur qui pour faire baisser les prix de l’immobilier d’un quartier qu’il vise, géolocalise de fausses agressions. Le journaliste spatialisé a dû apprendre à s’en méfier ou s’en servir dans une enquête.
À noter que d’autres acteurs sont apparus ces dernières années, les hackeurs, d’abord, dont certains effacent des zones entières de données ou les remplacent par d’autres. Il y a aussi et surtout des États qui utilisent cet espace pour y diffuser leur propagande ou générer la confusion chez leurs adversaires. Monter une communauté l’une contre l’autre (en géolocalisant un faux acte de discrimination commis par la communauté adverse), s’attaquer à la réputation d’un opposant (en le géolocalisant dans un endroit malfamé) font partie des ressorts classiques de la propagande d’État géolocalisée. À charge pour le journaliste spatialisé de faire le tri et de ne pas se laisser tromper.
Les journalistes eux-mêmes peuvent poser problème. Notamment les paparazzis qui ont trouvé un terrain de jeu inespéré dans cet espace de géolocalisation de contenus laissés par les people ou leurs proches. On ne compte plus les carrières brisées à cause d’une simple donnée géolocalisée. La question de la confidentialité des données est plus que jamais d’actualité.
Comme pour toute innovation technologique majeure, ce dispositif donne lieu à des pratiques inédites qui changent en profondeur la façon dont le journaliste de 2027 travaille et communique. Pour improbable et inquiétant qu’il soit ce nouvel environnement (les articles qui viennent se sédimenter autour de nous) constitue une archive inestimable de l’histoire des choses et des lieux qui nous entourent.